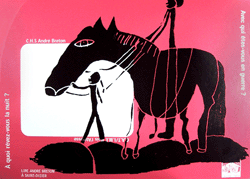L'affaire Klapahouk (retour au sommaire)
 Pouvoir
et prati-que psy-chanaly-tique
Pouvoir
et prati-que psy-chanaly-tique
De 1963 à 1972.
La circulaire sur la sectorisation hospitalière 1960 prévoyait en premier lieu la mise en place interne des hôpitaux psychiatriques par services selon l’aire géographique correspondante dans le département (pour la Haute-Marne, Saint-Dizier, Chaumont, Langres). A l’H.P. de Saint-Dizier cette restructuration se réalise progressivement vers 1963.
Avant cette date un couple de psychiatres règne en maître sur l’établissement et se partage les douze pavillons (six pour les hommes, six pour les femmes). A l’admission, l’interné est orienté au choix du médecin, et à “ mauvais malade ” correspondent toujours “ mauvais sévice et mauvais traitement”. La logique de ce système implique un rapport soignant/soigné articulé sur l’alternative récompense/punition et une coercition latente, qui nécessite une solide hiérarchie administrative et médicale au sommet de laquelle rayonne “ le Roi Soleil et Madame ”.
Le médecin-chef désigne son bras droit le surveillant-chef, choisi non sur des critères professionnels mais parce qu’il est “ le meilleur de ses sujets ” (cette confiance lui assurant l’impunité et les pleins pouvoirs).
Entre ce surveillant-chef et les infirmiers de chaque pavillon, autant de surveillants d’unité de soins, chargés de la bonne exécution des ordres. Les infirmiers pour leur part naviguent au gré des humeurs du surveillant-chef et s’ils peuvent se cacher lors de la visite du médecin, il n’en est pas de même des responsables d’unité de soins, véritables tampons entre “ leurs hommes ” et les autorités médico-administratives.
A cette époque, la “ visite ” est un rituel auquel on sacrifie une grande partie du travail de la journée : nettoyage des salles, hygiène des malades, tenue vestimentaire, retiennent l’attention du médecin dont un guetteur sourd-muet prévient l’arrivée ; lors de l’inspection le silence est total. La magie du pouvoir se matérialise par des listes de sismothérapie : quarante à cinquante électro-chocs par jour, (dont il est dit qu’une bonne partie est infligée comme punition). Les activités socio-thérapiques se limitent à la kermesse de L’H.P., qui a l’avantage d’entretenir de bonnes relations avec l’extérieur en le sollicitant un fois l’an à “ visiter ses fous ”.
Pas de contacts entre les malades de sexes différents ; au réfectoire, des services séparés, au cinéma de même ; à la messe, les hommes d’un côté, les femmes de l’autre ; la non mixité parachève l’image de l’hôpital-prison et consacre le Pouvoir des paléo-psychiatres. Avec l’arrivée en septembre 1964 du Docteur Lepenne, les premières “ innovations ” s’amorcent. L’hôpital est divisé en trois grands services :
Service A région Lanares
Service B région Chaumont
Service C région Saint-Dizier
Les 430 agents sont répartis dans les différents services, et le service C que nous allons suivre comprend 198 lits et 73 infirmiers dont 11 surveiIlants d’unité de soins.
Le respect par chacun de la hiérarchie figée de l’ancien système bloquait toute possibilité d’échange thérapeutique. En instituant des réunions pavillonnaires (médecins, malades, infirmiers) dont la fréquence varie des pavillons ouverts aux pavillons fermés (malades chroniques, agités), le docteur Lepenne va amorcer un processus de crise permanente de l’institution, dont les événements actuels sont une conséquence lointaine.
Introduire la communication, dans un monde clos qui se survit de la séquestration de chacun, par les “ diktats ” médico-policiers, c’est introduire le loup dans la bergerie et concrètement vouloir déstructurer les rapports de pouvoirs établis. La circulation de la parole permet certes l’amorce d’une relation thérapeutique en libérant les échanges individuels et collectifs mais elle donne naissance également à des antagonismes qui font émerger des enjeux contradictoires.
Les malades possèdent désormais les mêmes droits d’expression et de contestation que l’infirmier et s’organisent. Ils revendiquent de meilleurs conditions d’existence, luttent pour une amélioration de la nourriture, ce qui leur permet de s’unifier. Les infirmiers, pour leur part, abondent dans le sens des revendications des malades tant que leur pouvoir ne se trouve pas ébranlé. Le médecin qui a aboli son pouvoir autocratique au profit d’un savoir psychiatrique moderniste fortement imprégné par le courant “ psychothérapie institutionnelle ” favorise les conditions d’une restructuration qui va, finalement, sinon s’effectuer à ses dépens, du moins aboutir à un résultat imprévu. En effet, par son comportement neutre et bienveillant, le médecin oscille en fait entre les deux groupes en présence. Pour se dégager de la tutelle des infirmiers et de la dépendance des malades, il ne peut que prendre ses distances et par là se laisser réintroniser dans un pouvoir que soutiennent sa supériorité intellectuelle et ses qualités humaines.
La dépendance des infirmiers et des malades réapparaît et réinvestit le psychiatre dans sa fonction charismatique à laquelle il avait cru pouvoir échapper, comme si sa position de “ psy ” à l’intérieur de l’institution était compatible avec une neutralité quelconque. Investi d’une demande collective (et sans doute pour d’autres raisons) à laquelle il ne peut que répondre, le Docteur Lepenne, selon un rituel désormais classique annonce son prochain départ (juillet 1967).
La réorganisation se poursuit et l’H.P. toujours divisé en trois services laisse apparaître un développement thérapeutique inégal. Dans le service A (Dr Nique), la mixité est désormais acceptée (malades hommes/femmes de la région de Langres, la plus éloignée de Saint-Dizier), la thérapie institutionnelle est de règle.
Le service B (Dr Teboul) regroupe les femmes des régions chaumontaises et bragardes (Saint-Dizier), un pavillon réunit les enfants de sexe féminin du département. Une ergothérapie occupationnelle est en place.
Quant au service C qui regroupe les hommes des régions de Chaumont et de Saint-Dizier, ainsi que les garçons du département, sa situation dans l’hôpital est des plus préoccupante. Locaux vétustes, non mixité, insuffisance marquée en personnel infirmier, aggravent les conditions d’exercice d’une entreprise soignante qui n’en est pas encore au stade de l’ergothérapie.
En l’absence d’un remplacant au Docteur Lepenne, les Docteurs Nique et Teboul assurent l’intérim ; ils accentuent les diverses réformes commencées par leur prédecesseur et les infléchissent dans un sens didactique (formation du personnel et des élèves-infirmiers, organisation d’une scolarité pour les enfants, etc.).
Survient Mai 68. Ces jeunes psychiatres tentent d’impulser un “ comité de gestion ”, leur formation intellectuelle les constituant en “ avant-garde ” d’un personnel infirmier hésitant. (A Saint-Dizier les psychiatres n’ont rien à perdre, les infirmiers, gens du cru, n’ont qu’une incertaine promotion interne à espérer). La tentative reste vaine. Néanmoins le climat d’unité ainsi créé va favoriser la mise au point par les trois médecins (Nique, Teboul et Boige qui a enfin remplacé Lepenne) d’un véritable “ putsch ” contre l’administration de l’H.P.
Sous prétexte de contrôle thérapeutique, un beau matin d’avril 1969, les médecins interdisent le travail des malades (une centaine) dans les services d’entretien de l’hôpital. Cette affaire est d’importance : elle traduit, dans ce cas particulier, l’affirmation du “ Pouvoir médical ” contre le “ milieu administratif et politique.
Après le départ échelonné des psychiatres contestataires, le Docteur Lauff, nouvel arrivant, assure la transition conduisant au Docteur Klapahouk. Avec lui le service C fait quelques timides pas vers l’extérieur : mise en place du foyer de post-cure, constitution d’équipes paramédicales en ville, etc. ; à l’intérieur, le travail de psychothérapie institutionnelle se poursuit en dépit de l’omnipotence réaffirmée de l’administration.


Le
personnel de l'hôpital psychiatrique maintient son action
et conteste les propos de son médecin-chef.
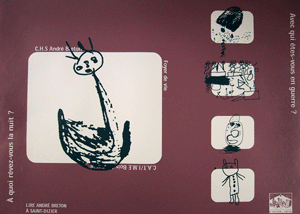
Un
inspecteur général de la Santé Publique
enquête à Saint-Dizier

La
sectorisation: La sectorisation psychiatrique évoquée
au Conseil général.

Hôpital
psychaitrique: le Docteur Klapahouk suspendu de ses fonctions.
Dossier de presse
Dans le Monde du 15-11-1973, Francis Cornu présente sous le titre “ Des infirmiers qui ne croient pas à la psychiatrie, une synthèse du conflit qui opposa le médecin-chef au personnel de son service. Nous ne reproduisons pas cet article et préférons restituer l’intégralité des articles de presse locaux qui introduisent mieux, dans leur succession insistante, au vécu du conflit marqué par ses inquiétudes et ses non-dits.
Reprendre la lecture d'André Breton.

Un
différend sérieux oppose un médecin-chef de
l'hôpital psychiatrique de Saint-Dizier au personnel de son
service et à la direction de l'établissement.
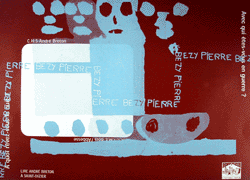
Un
médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de
Saint-Dizier viole le secret professionel

Le
docteur Klapahouk, médecin-chef de l'hôpital
psychiatrique départemental est suspendu de ses fonctions.

L'affaire
de l'hôpital psychiatrique: le C.G.T. Précise sa
position. Et
quelques précisions.