Entretiens avec le personnel soignant.
Jaqueline Collet. Florence Perchet. Denise Hanser. Alain Tamisier. Robert Camus. Blanche Janet. Antoine Bounader. Louisette Meier. Daniel Laage. Michel Mori. Sylvie Petit. Claude Lafarge.
Reprendre la lecture d'André Breton à Saint-Dizier.
Louisette Meier
L’accueil Tosquelles
Louisette Meier : Nous sommes à l’accueil Tosquelles qui se trouve au Clos Mortier. C’est un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel qui, à l’origine, a été créé comme un bistrot idéal. Il y a 6 ans environ qu’il a été ouvert à l’initiative du docteur Mori. Le médecin souhaitait qu’il y ait un lieu chaleureux, convivial pour des patients qui sont souvent raillés dans les cafés de la ville. Ce sont les patients qui organisent en gros la journée. Ils sont acteurs du lieu. Il n’y a pas de plages horaires instaurées. L’accueil est ouvert de 9 heures 30 à 17 heures 30 et les patients viennent comme ils veulent. Parfois, ils viennent manger. Ils amènent leur repas.
Un lieu anti-institutionnel
L.M : Au départ, j’étais en unité. On a su que Tosquelles ouvrait et cela m’intéressait de sortir de l’hôpital et d’investir un lieu autre. J’ai amené des patients qui étaient hospitalisés pour passer un moment à Tosquelles le dimanche. Par la suite, j’ai été volontaire pour travailler ici. Je me suis dit qu’aller dans un autre lieu que l’hôpital ne pouvait déboucher que sur des choses positives.
Stéphane Gatti: Qu’est-ce que cela modifie dans vos rapports avec les gens dont vous vous occupez ?
L.M : C’est un lieu anti-institutionnel. On n’est pas dans l’hôpital. Ce n’est pas la pathologie qui est au premier plan. C’est le sujet en tant que sujet. C’est notre travail de chaque jour d’essayer qu’il soit sujet, acteur et non pas dépendant de l’institution, aliéné par l’institution. C’est un travail journalier que d’essayer de “renarcissiser” chacun, de découvrir les potentialités de chacun et de les faire ressortir.
L’institution psychiatrique
L.M : C’est difficile dans l’institution parce qu’il y a des notes de service, des choses qui tombent comme ça. Si elles étaient appliquées à la lettre, on serait hors sens. C’est toujours le cloisonnement l’hôpital. Chaque médecin à son secteur. Pour un psychotique qui est déjà morcellé, si l’hôpital est morcellé, si les prises en charges sont morcellées... Il faut être au plus près de leur âme. Accueillir chacun de façon individuelle. Essayer d’être au plus près de chacun en tant que sujet, pas en tant que pathologie. La pathologie n’est pas au premier plan ici. Puis, faire en sorte que chacun soit acteur du lieu aussi. C’est important. Il y a des patients qui accueillent les personnes qui arrivent.
Marnaval
L.M : Je suis née à Marnaval dans la cité ouvrière. C’est vrai que cela forge un caractère quelque part. On a vécu des moments difficiles. Un petit salaire d’ouvrier, de grandes grèves, aucune commodité dans la maison. A ce moment-là, les cités, c’étaient déjà les pauvres de Marnaval. Les maisons neuves étaient en haut et c’étaient déjà les riches de Marnaval. C’étaient des petits chefs, des gens comme ça. Il y avait déjà une séparation entre les pauvres et les riches à Marnaval. Il y avait une tradition importante de luttes ouvrières. Les grèves étaient dures. Je me rappelle avoir vu des voitures foncer sur les grévistes. Des choses comme cela qui marquent quand on est enfant. On avait le sentiment d’appartenir à une classe. C’était quelque chose.
Son parcours
L.M : J’étais dans le secrétariat. J’étais secrétaire administrative à la fédération du parti communiste à Saint-Dizier. Quand j’ai été licenciée, pour raisons économiques, pour trouver du travail derrière cela, c’était pas facile du tout. Quand j’ai tenté le concours d’élève infirmière, c’était la dernière année où on pouvait être salarié. J’ai passé l’écrit puisque j’avais arrêté avant le baccalauréat. J’ai passé l’écrit et je me suis dit que j’avais peut-être une chance. Cela n’était pas compliqué et puis à l’oral, alors là, c’était pas la même chose. On a tout de suite abordé le problème politique. J’ai défendu mes idées. Je suis restée 40 minutes à l’entretien alors que normalement 15 minutes suffisaient. Après, on a abordé les questions bateaux. En sortant de l’entretien, je me suis dit : “ S’ils sont honnêtes, cela devrait marcher, mais si... ” Et je suis rentrée à l’hôpital.
Evolution de l’institution
L.M : Je pense qu’il y a une évolution et qu’il y a des gens qui bougent pour faire avancer les choses. Dans toutes les unités, il y a une rébellion à l’ordre établi, au fait que le patient, quand il entre à l’hôpital, ce n’est pas un objet.
S.G : Quels changements importants vous semble-t-il qu’il y a eu entre 1980 et aujourd’hui ? Est-ce qu’il y a eu des étapes particulières ou est-ce plutôt un lent changement intérieur ?
L.M : C’est plutôt un lent changement intérieur, mais actuellement il y a un arrêt de ce changement. J’ai l’impression qu’il y a un poids plus important de l’institution comme un retour en arrière avec ce cloisonnement, ces grillages partout dans l’hôpital.
Les patients à Tosquelles
L.M : Ils savent que je suis infirmière. Personne ne l’oublie, mais il y a quelque chose de convivial qui fait que les patients parlent plus librement. Il n’y a pas le jugement, le poids de l’équipe, de l’institution, des retombées. Le patient nous raconte les problèmes d’autres patients qui ne viennent pas forcément ici. On nous téléphone pour nous dire que tout va bien. A Tosquelles, on sent qu’il y a de la vie : des choses se passent, les relations sont assez profondes. La difficulté de notre travail ici, c’est justement de garder la distance thérapeutique, avoir toujours à l’esprit qu’on est soignante. Dans le groupe qui vient à Tosquelles, il y a des liens qui se sont tissés. Les patients s’invitent chez eux à boire un café. Ils se rencontrent, ils discutent ensemble. Tosquelles existe en tant que lieu rassembleur. Il y a des difficultés aussi parce que chez un psychotique, l’autre n’existe pas. C’est encore plus difficile quand l’autre est maghrébin. On a eu des propos racistes. On a sans arrêt à revenir la-dessus. Le respect de l’autre ici est primordial. C’est un lieu de libre parole dès l’instant où l’autre est respecté. C’est la seule règle à Tosquelles. Il y a une petite carte sur le tableau : “Tous pas pareils et tous égaux”. C’est du M.R.A.P. Cela résume tout à fait les patients.
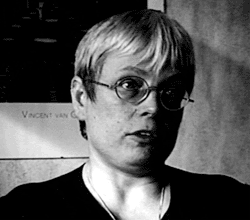
Louisette
Meyer, infirmière. Fille d'une famille ouvrière de
Marnaval, aujourd'hui elle s'occupe du centre de Tosquelles. En
marge de l'institution.
