Entretiens avec le personnel soignant.
Jaqueline Collet. Florence Perchet. Denise Hanser. Alain Tamisier. Robert Camus. Blanche Janet. Antoine Bounader. Louisette Meier. Daniel Laage. Michel Mori. Sylvie Petit. Claude Lafarge.
Reprendre la lecture d'André Breton à Saint-Dizier.
BLANCHE JANET
Porter cette parole
Blanche Janet: J’ai pas trop senti cette parole du patient jusqu’à une époque très récente même si dans les espaces où l’on travaille, dans les ateliers d’expression, les patients s’expriment. L’idée de porter cette parole ou de la transmettre est parfois jugée un petit peu de façon péjorative. Cette parole là, on ne veut pas toujours l’entendre. C’est difficile d’être dans un atelier d’ex-pression et d’être porteur de cette parole. Je trouve que cela change maintenant. Plus qu’il y a une dizaine d’années. Je ne peux pas mettre le doigt à l’endroit où s’est fait ce changement mais cela communique beaucoup plus… Cette ouverture de l’hôpital, ce changement d’approche du patient. Je me suis beaucoup occupée de patients que l’on appelle : “ hors réalité ”. Cette parole-là est difficilement accessible puisqu’il y a un problème de communication. Maintenant, on considère ces problèmes comme, peut-être, non complètement guérissables, mais on peut travailler avec celui qui est hors réalité. Avant, l’idée était qu’il n’y avait pas de possibilités d’accéder. Il n’y avait pas de changements possibles. Le milieu médical a maintenant une autre vision des gens qui sont hors réalité. Ils le sont pour un temps, pas définitivement.
La mixité du personnel infirmier.
B.J : Cela a commencé à changer quand il y a eu un recrutement d’au moins cinquante infirmiers en 1968. Cela a pu commencer à changer parce qu’on était les premières femmes à entrer dans le service adulte hommes. Avant, c’était séparé. Le docteur Nique avait déjà établi la mixité dans son service. Je ne parle pas de la mixité des patients mais du personnel infirmier.
L’atelier Léontine G.
B.J : On parle d’art thérapie. Je dirais thérapie d’expression et de créativité. On intervient à travers plusieurs ateliers. L’accueil se fait différemment suivant les endroits où l’on se trouve. A la fabrique Dupré, les patients sont accueillis en groupes sur indication du médecin. Il y a plusieurs degrés d’approche en art thérapie. Echapper à ses préoccupations est un degré souvent utilisé avec les patients en groupe. Le second degré est ce que j’appelle la vraie action : exprimer pour se décharger d’une émotion. Le troisième degré que l’on pratique plus dans les pavillons comme les Glycines est la vraie action et l’élaboration à l’extérieur de soi. Ici, à Léontine G. on est plutôt dans l’idée d’une initiation. Il y a un atelier peinture, dessin et modelage. C’est un atelier qui a été ouvert sur la demande du docteur Mori. Les conditions d’accueil sont : vouloir peindre et respecter le travail réalisé par les autres patients. Les personnes accueillies viennent de l’hôpital de jour. Elles sont reçues régulièrement quand elles n’ont pas d’autres ateliers. Alors, les dessins sont là.
Stéphane Gatti: Racontez-nous quelques dessins ?
B.J : Je vais plutôt parler de la personne qui produit énormément. C’est une personne qui vient des Lilas. C’est un autre pavillon qui est lié à Léontine G, mais c’est un pavillon d’hospitalisation. C’est une jeune fille qui aime beaucoup la peinture. Chaque fois qu’elle arrive, elle a une idée de ce qu’elle veut faire et elle se met à peindre. Je me contente de lui donner la matière pour faire et que l’ambiance soit propice à la création. Il n’y a pas de jugement. Juste un encouragement à élaborer ces peintures.
S.G : Est-ce qu’il y a une histoire qui se met en place autour de ses différents dessins ?
B.J : Non, pas dans son cas. Elle parle très peu d’elle. Le choix des motifs, de ce qu’elle peint a à voir avec son histoire. Mais je ne la questionne pas. Elle n’en parle pas, je ne questionne pas. L’essentiel est qu’elle puisse venir peindre. Il faut simplement accueillir ce qui se dit dans la peinture. On ne comprend pas toujours ce qui est dit.
Le patient adulte et son histoire
B.J : Il y a l’histoire du patient. Il y a l’histoire de sa maladie, les rechutes. Parler du patient et de résistance. Elle est chez le patient dans le sens où il s’agit de chronicité. Chaque rechute renforce cette difficulté à s’en sortir. C’est difficile de changer, de s’exprimer. Il y a peut-être une sorte de renoncement à force de rechuter. Dans les équipes soignantes, la formation est différente. Le fait d’avoir le médicament entre soi et l’autre dans la pratique fait une différence. Avec les enfants, il n’y en a pas. C’est la relation qui est forte.[…] Quand on est en atelier d’expression, il est intéressant de repérer une position de continuité. On peut rencontrer un patient pendant des années. Au cours de ces rencontres successives, l’histoire se raconte. On en a régulièrement des petits bouts.
Activités et parole
B.J : A Saint-Dizier, dans le service adulte, il n’y avait qu’une partie de ces personnes hospitalisées qui étaient dans les espaces de travail. J’ai vu les patients qui n’avaient pas la possibilité de travailler, ni de faire autre chose. Ce que j’en avais perçu était le vide mental. Le vide de ne rien faire de sa journée, même pas de jouer.
S.G. : Pour qu’il y ait écoute, il faut en créer les conditions. Si rien ne leur est proposé, c’est le vide. Les activités sont aussi une possibilité de créer de l’écoute.
B.J : C’est une médiation et là se trouve une possibilité que le patient dise quelque chose de lui ou de sa vie. Autrement, chacun est à l’intérieur de soi et chacun se croise.
Dire ce métier
B.J : C’est très difficile de faire partager le monde de la psychiatrie ou de la folie à quelqu’un qui ne l’a pas vécu. Mais j’en parlais un peu chez moi quand il y avait un patient qui avait progressé ou qui s’en était sorti. Je partageais cela. Sinon, nous travaillons en équipe. Le partage se fait aussi avec la collègue art-thérapeute ou le collègue ferronnier. Il y a des choses qui nous bouleversent. Et, nous avons la possibilité de travailler avec un psychologue toutes les semaines. Nous parlons un petit peu des émotions vécues. Mais c’est vrai que je parle assez facilement des choses qui marchent bien à la maison. Cela renforce.
Le verger
B.J : L’hôpital fonctionnait en autarcie et il y avait un jardin là et tout ça c’était des jardins, le service enfant (actuel). Il reste le verger. C’est magnifique , on peut y aller. Il est très, très beau quand c’est le printemps. C’est plein de fleurs. C’est vraiment très, très beau. C’est les fruits. C’est plein de choses. C’est quelque chose d’apaisant aussi. Les patients y sont libres. Il y a quelque chose de vivant. Cela se fait un peu moins parce qu’il y a des règles d’hygiène qui s’établissent, mais avant, assez souvent, on faisait des tartes aux pommes ou des choses comme ça. Il y a de très bonnes pommes. C’est un grand verger. Il y a des pommes. Il doit y avoir des cerises, des poires et au centre il y avait une petite place avec un gros noyer, vraiment un énorme noyer qui était là. C’est l’endroit que je préfère.
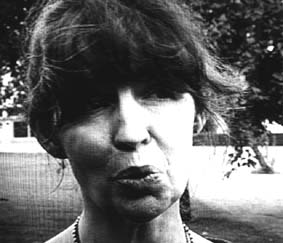
Blanche
Janet, art-thérapeute
